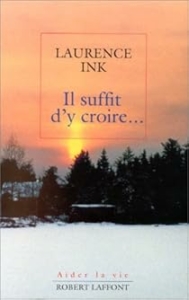 – Nakane. Arrivée dans cinq minutes…
– Nakane. Arrivée dans cinq minutes…
Une main me pousse légèrement l’épaule, me tire d’un sommeil noir comme l’eau profonde d’un puits. Dans la pénombre, je distingue un visage inconnu, surmonté d’un casquette inclinée sur l’oreille aux insignes de la compagnie ferroviaire.
– Nakane. On arrive dans cinq minutes. Quand vous serez prête, vous remonterez le wagon, on descend au deuxième.
Et il s’éloigne d’un pas sûr, prenant appui sur le dossier des fauteuils lorsque les cahots le font vaciller.
Je n’ai dormi que quelques heures, recroquevillée sur mon siège, et reprends pied dans un décor qui m’est étranger. La voiture est éclairée par la lumière blafarde des veilleuses. Ça et là des corps sont étalés dans des poses presque obscènes, comme jetés sur les banquettes inconfortables, les têtes posées sur des oreillers de fortune, les jambes dépassant dans l’allée. Un gros homme au visage luisant de sueur a posé ses pieds chaussés de lourdes bottes de chantier sur le fauteuil qui lui fait face et dort la bouche ouverte, la nuque renversée en arrière, ponctuant d’un ronflement sonore la trépidation des moteurs et le grincement strident des wagons qui brinquebalent par secousses. Le sol est jonché de détritus, bouteilles vides qui roulent d’avant en arrière, papiers gras, enveloppes argentées de chips.
Même les contrôleurs ont dû changer, je ne reconnais pas dans celui qui m’a réveillée, souriant mais un peu débraillé, l’employé impeccable de mon départ, à Montréal.
Il fait trop sombre pour distinguer l’heure à ma montre, mais il doit être dans les 4 ou 5 heures du matin. Ces dix heures de voyage m’ont déjà coupée du monde connu, de la ville où tout se déroule selon une logique préétablie ; je tente d’apercevoir le paysage par la vitre mais, opaque de givre, elle ne me renvoie que ma propre image, aux traits flous et bouffis de fatigue. Pour me rassurer, je me répète que jusqu’à présent tout s’est à peu près déroulé comme prévu, qu’après mon voyage d’avion depuis Paris j’ai pu attraper in extremis le train à Montréal ; à mon arrivée, quelqu’un sera là pour m’attendre, à la date et à l’heure fixées quelques semaines auparavant. Mais une angoisse incoercible me noue le ventre, j’ai la bouche sèche et les doigts qui tremblent en laçant mes bottes.
De l’autre côté de l’allée, un passager me fixe d’un air las, une cigarette à la main, les traits tirés et immobiles. Tandis que je rassemble mes vêtements épars, je sens son regard posé sur moi, avec l’impassibilité de l’attente, et mon sentiment de malaise s’alourdit dans cette atmosphère de limbes, hors du temps, zone de transit pour un autre monde.
Je remonte vers la tête du train, titubant comme une personne ivre, et rejoins le wagon réservé aux bagages où mon sac à dos et mes valises bardées d’étiquettes sont regroupés près de la porte, déjà ouverte, qui m’envoie une bouffée d’air glacial.
Sautant d’un pied sur l’autre, les mains profondément enfouies dans les poches de son manteau, le contrôleur me parle, de la température sans doute, qui doit friser les moins 30°. Je hoche la tête sans répondre, trop abrutie de fatigue pour le faire répéter.
Le talkie-walkie grésille :
– Encore deux miles, on arrive…
Dehors le ciel est opaque, la neige le long des rails semble grise et sale. Aucune lumière ne scintille dans l’obscurité que voile le rideau mouvant d’une neige fine.
Le contrôleur me regarde avec attention et une lueur d’étonnement.
– Le prochain train est dans deux jours. Quand vous voudrez redescendre, vous avez juste à flasher[1] en avant du Voyageur quand il arrive…
J’ai l’impression qu’il attend une précision, la date de mon retour, la raison de cet arrêt en plein milieu de la forêt sauvage par une nuit glaciale de décembre. Mais peut-être n’est-ce que l’écho de ma propre inquiétude.
Il se penche un peu à l’extérieur, et je me demande ce qu’il peut apercevoir avec ces flocons qui lui tombent dans les yeux.
– Encore un peu, encore… OK, c’est beau.
Les freins crient, le train hoquette et tressaute, s’immobilise.
En sautant du train, je tombe dans une neige molle et m’enfonce jusqu’aux genoux. La vapeur mêlée de fumée que dégagent les moteurs m’enveloppe d’un brouillard blanc et humide qui me laisse tout juste distinguer le carré lumineux du wagon. On me tend mes bagages à la hâte, je compte fébrilement mes valises pour être sûre de n’avoir rien oublié ; le contrôleur me fait un signe de la main avant de refermer la porte, le train s’arrache en cliquetant, et s’ébranle. Ma gorge se serre à étouffer, mais déjà il s’éloigne, avec un dernier éclat de ses feux arrière.
Du halo laiteux laissé par le convoi émergent doucement les silhouettes noir et blanc des épinettes, je scrute en vain les ombres, personne ne m’attend. Au-dessus de ma tête, il n’y a pas d’étoiles, juste l’ébauche d’une clarté diffuse qui annonce l’aube et dessine quelques ombres de nuages sur la noirceur du ciel.
Éditions Robert Laffont, 1994 (France Loisirs, 1995 ; J’ai Lu, 1996)
[1] Flasher : pour arrêter le train de voyageurs, hors des arrêts obligatoires, il suffit de faire des signaux avec une lampe de poche.
