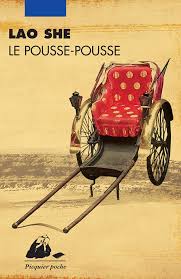 Bel homme, beau pousse : et quel pousse ! Les arcs étaient souples, si souples, que les brancards tremblaient légèrement pendant la course. Le coffre était étincelant, et le coussin du siège d’une blancheur immaculée. L’avertisseur lançait des sons éclatants. Avec un tel engin, courir vite n’est pas seulement une question d’amour propre, c’est un devoir. Sans la vitesse, comment mettre pleinement en valeur la beauté de son pousse et celle de son propre corps ? Au bout de six mois, le pousse avait l’air de se comporter comme un être vivant. Au moindre mouvement de Siang-tsé, un coup de reins ou un ploiement de jambes, il répondait immédiatement, par une aide des plus opportunes et des plus efficace. Entre eux, pas l’ombre d’un malentendu ou d’un accro. Sur terrain plat, lorsqu’il n’y avait pas d’encombrements, bercé par le bruit léger et rythmé, Siang-tsé avait l’impression d’être poussé par la rotation des roues, comme par une brise rapide. Arrivé à destination, ses vêtements lui collaient au corps, tout trempés de sueur, comme s’ils étaient sortis d’une bassine d’eau. Il ressentait de la fatigue, mais une fatigue agréable, et qui lui procurait un sentiment de fierté, tel un cavalier qui vient de parcourir sur son coursier quelques dizaines de lis au grand galop. (p.21)
Bel homme, beau pousse : et quel pousse ! Les arcs étaient souples, si souples, que les brancards tremblaient légèrement pendant la course. Le coffre était étincelant, et le coussin du siège d’une blancheur immaculée. L’avertisseur lançait des sons éclatants. Avec un tel engin, courir vite n’est pas seulement une question d’amour propre, c’est un devoir. Sans la vitesse, comment mettre pleinement en valeur la beauté de son pousse et celle de son propre corps ? Au bout de six mois, le pousse avait l’air de se comporter comme un être vivant. Au moindre mouvement de Siang-tsé, un coup de reins ou un ploiement de jambes, il répondait immédiatement, par une aide des plus opportunes et des plus efficace. Entre eux, pas l’ombre d’un malentendu ou d’un accro. Sur terrain plat, lorsqu’il n’y avait pas d’encombrements, bercé par le bruit léger et rythmé, Siang-tsé avait l’impression d’être poussé par la rotation des roues, comme par une brise rapide. Arrivé à destination, ses vêtements lui collaient au corps, tout trempés de sueur, comme s’ils étaient sortis d’une bassine d’eau. Il ressentait de la fatigue, mais une fatigue agréable, et qui lui procurait un sentiment de fierté, tel un cavalier qui vient de parcourir sur son coursier quelques dizaines de lis au grand galop. (p.21)
 Passé le pont Kao-liang, Tsiang-tsé s’assit sur la berge et se mit à pleurer.
Passé le pont Kao-liang, Tsiang-tsé s’assit sur la berge et se mit à pleurer.
Le soleil se couchait. Les vieux saules, aux cimes teintées d’or, se penchaient. La rivière n’était en réalité qu’un mince filet d’eau, dans lequel traînaient des herbes, en longs rubans vert foncé et odorants.
Au nord de la rivière, les blés montraient déjà leurs épis couverts de poussière. Au sud, les feuilles de lotus flottaient nonchalamment sur de petits étangs ; autour des feuilles, se formaient sans cesse des bulles fragiles. Sur le pont, les passants semblaient s’agiter encore plus frénétiquement dans la lumière du couchant, comme s’ils avaient été pressés par l’approche de la nuit. Tout ce petit monde était terriblement vivant aux yeux de Siang-tsé. Pour lui, ce qu’il avait en face de lui – la rivière, les arbres, les blés, les feuilles de lotus, le pont, les passants – était ce qu’il y avait de plus attachant au monde, puisque ces choses appartenaient toutes à la ville, sa ville.
Pourquoi donc se presser ? Il faut savoir s’accorder le loisir de goûter ces spectacles délicieux et familiers. Après être resté longtemps assis, il alla près du pont, pour manger un bol de pâtes de soja. Ces pâtes tendres et chaudes, assaisonnées de vinaigre, de sauce de soja, d’huile de piment et de persil, dégageaient une odeur exquise. Siang-tsé en eut le souffle coupé. Les yeux fixés sur le persil haché d’un vert tendre, il sentir le bol trembler entre ses mains. (P.41)
 Dans ce bas monde, les paroles vraies sont rares. Un visage de femme qui rougit vaut cependant mille paroles vraies. Même Siang-tsé comprit la pensée de Petite Foutse. Il la considérait comme la plus belle fille du monde, car sa beauté venait de l’intérieur. Même si elle avait le visage grêlé, elle serait toujours belle. Elle était jeune et travailleuse : si Siang-tsé voulait se remarier, il ne pouvait pas mieux choisir. Malheureusement, Siang-tsé n’y songeait pas pour l’instant. Toutefois, si elle l’avait désiré, et si, pressée par ses conditions de vie, elle l’avait proposé à ce moment, il aurait été difficile à Siang-tsé de refuser. Oui, sensible à sa personne et à ce qu’elle avait fait pour lui, il ne pouvait qu’accepter. D’ailleurs, si près d’elle, il eut envie de la serrer dans ses bras. Ils pleureraient ensemble jusqu’à ce qu’ils eussent surmonté leur chagrin, et ensemble, ils continueraient la route. Il découvrit en elle toute la consolation qu’un homme peut attendre d’une femme. Lui, le taciturne, avait toujours aimé bavarder avec elle. Il lui semblait que, lorsqu’il s’adressait à elle, tout ce qu’il disait, n’était pas vain. Et venant d’elle, un hochement de tête, un sourire, étaient une réponse des plus aimables. À travers elle, il entrevît l’intimité d’un vrai foyer. (P. 183)
Dans ce bas monde, les paroles vraies sont rares. Un visage de femme qui rougit vaut cependant mille paroles vraies. Même Siang-tsé comprit la pensée de Petite Foutse. Il la considérait comme la plus belle fille du monde, car sa beauté venait de l’intérieur. Même si elle avait le visage grêlé, elle serait toujours belle. Elle était jeune et travailleuse : si Siang-tsé voulait se remarier, il ne pouvait pas mieux choisir. Malheureusement, Siang-tsé n’y songeait pas pour l’instant. Toutefois, si elle l’avait désiré, et si, pressée par ses conditions de vie, elle l’avait proposé à ce moment, il aurait été difficile à Siang-tsé de refuser. Oui, sensible à sa personne et à ce qu’elle avait fait pour lui, il ne pouvait qu’accepter. D’ailleurs, si près d’elle, il eut envie de la serrer dans ses bras. Ils pleureraient ensemble jusqu’à ce qu’ils eussent surmonté leur chagrin, et ensemble, ils continueraient la route. Il découvrit en elle toute la consolation qu’un homme peut attendre d’une femme. Lui, le taciturne, avait toujours aimé bavarder avec elle. Il lui semblait que, lorsqu’il s’adressait à elle, tout ce qu’il disait, n’était pas vain. Et venant d’elle, un hochement de tête, un sourire, étaient une réponse des plus aimables. À travers elle, il entrevît l’intimité d’un vrai foyer. (P. 183)
Le roman, à partir d’une nouvelle écrite en 1936 et publiée en feuilleton dans la revue Yizhoufeng, paraît en 1937. Très vite une référence, il est vu comme un réquisitoire contre l’Ancien Régime, recommandé dans les écoles pour l’éducation des masses laborieuses.
Cela ne durera qu’un temps.
Dans sa philosophie, le texte est imprégné d’éléments autobiographiques. D’origine mandchoue, Shu Qingchun 舒慶春(1899-1966), Lao She pour son nom de plume, a connu dès l’enfance les renversements du sort, son père, soldat de la garde impériale, ayant été tué alors qu’il n’a que deux ans, lors de l’arrivée des troupes étrangères venant écraser la rébellion des Boxers. Il a douze ans lors de la révolte dite Xinhai qui marque la fin de l’Empire et la prise du pouvoir par les Han. Pauvre, ostracisé par les nouveaux maîtres, il parvient à continuer ses études pour intégrer l’École normale de Pékin.
D’abord fonctionnaire, chargé de missions en province, il démissionne en 1921 pour être secrétaire d’une école privée à Pékin et commence à écrire, dans une atmosphère nationale alors en pleine effervescence politique et littéraire. En 1924, converti au christianisme, il obtient un poste de professeur de chinois à l’École des Études orientales de Londres. Il y découvrira notamment Dickens et Conrad.
La Chine de 1930 où il revient est en pleine guerre civile, opposant nationalistes et communistes, sous la menace de l’expansion japonaise. Ayant fait le choix d’un poste d’enseignant à Jinan (province de Shandong, récemment revenue à la Chine), Lao She se tient à l’écart de la politique et publie en revues romans et nouvelles où l’étude des caractères prend peu à peu une place prépondérante. La seconde guerre sino-japonaise (1937) le décide à entrer dans l’arène du mouvement littéraire nationaliste. Président de la « Fédération nationale antijaponaise des Écrivains et Artistes de toute la Chine » et éditeur de son journal, il devient une figure majeure du monde des lettres jusqu’en 1946.
Initialement convié à une série de conférences aux États-Unis, il y demeurera finalement trois ans, pour ne revenir à Pékin que fin 1949, alors que la République populaire vient d’être fondée. Il continue à écrire, des pièces de théâtre « édifiantes » (dont une version du Tireur de Pousse, nouvelles et romans, sans pour autant se définir comme marxiste.
Cette indépendance d’esprit le désignera à la vindicte de la Révolution culturelle de 1966. Battu et humilié en public par les Gardes rouges, sa maison et ses livres pillés, il sera trouvé mort trois jours plus tard dans un lac de la Capitale, sans que la thèse du suicide ne soit totalement reconnue. Il ne sera réhabilité qu’en 1978, alors que le monde occidental l’a découvert comme un auteur majeur, envisagé comme Prix Nobel en 1968.
« Xiangzi le chameau » sera (plutôt bien) adapté au cinéma en 1982 par Ling Zifeng.
Quelques titres traduits en français, parmi les plus remarquables :
Gens de Pékin, Folio, 1993, nouvelles.
Quatre générations sous un même toit, en trois tomes, Mercure de France et Folio, de 1998 à 2000 (préface de J.M.G. Le Clézio).
Histoire de ma vie, Folio Gallimard, 2002.
Voir :
Le Tireur de pousse-pousse à Madagascar
You Tube – Deadliest Road – 30 août 2024
Et, pour l’adaptation du roman :
Rickshaw Boy, de Ling Zifeng
Janvier 1982 (Chine)
