
– 2 – Marseille, 28 janvier 1999
N’est jamais parti celui qui ne s’est pas promené le long du dock d’un grand port. N’a vraiment voyagé que celui qui, un jour, s’est trouvé là, au pied de la passerelle de coupée, avec son balluchon ou ses cantines, minuscule à coté d’une coque de navire, qu’il soit goélette, paquebot, ou porte-conteneurs.
Un port de commerce est un monde à part. Monstrueux et fascinant. Silhouettes gigantesques des grues, masses balancées des conteneurs à dix mètres au-dessus des têtes, bruits sourds de fer entrechoqué et de chaînes qui coulissent, coques balafrées de rouille où elles régurgitent leurs ancres… Et des hommes – leur visage carré et leur air pas commode, ceux qui sont d’ici, qui attendent la fin de leur quart pour regagner leur foyer, et les autres, les étrangers, qui traînent leur désœuvrement en bordure d’un pays dont ils ne connaissent que ce bout de digue et les lumières de la ville, la nuit.
Derrière, la mer, encore discrète, qui attend son heure.
« Un ciel lourd et cuivré, effiloché, sur le point de se déverser en cataractes, traîne si bas qu’il dérobe au regard les étages supérieurs des tours inégales de la skyline, et réverbère les lumières de la ville en une sorte de crasseuse aurore boréale. Des terrasses désertes de la gare maritime, où n’accostent plus guère de paquebots, on voit diverger de noires avenues liquides, aux bords régulièrement jalonnés de ces fameux lampadaires au sodium. »
(Jean Rolin, La ligne de front)

Dans cette lumière glauque, passent les ombres de tous ceux qui un jour partirent. Sans espoir de retour, vers l’Eldorado des contrées d’Amérique, riches en terres. Avec des rêves de paradis, vers des colonies d’empire, là où l’or, dit-on, coule jusque dans les rivières, où l’on s’oublie dans l’odeur des épices et les profondeurs moites des forêts tropicales. Tous n’étaient pas partis de Marseille ; parfois, c’était à Bordeaux qu’ils avaient tourné le dos à leur passé, au Havre, à Dublin, ou à Liverpool… Il me semblait pourtant les voir là, pâles, les yeux fiévreux, crânant malgré le ventre noué, impatients de rompre enfin, de sceller leur pacte avec le rêve.
Car c’est très long, un bateau, à quitter la terre.
J’avais déambulé dans la ville, le cœur vacant, dans la lucidité et la solitude de la séparation, traîné sur les quais, avant de rejoindre la cabine qui m’était réservée sur le Catherine Delmas. J’avais imaginé un recoin de coursive, habitée du bruit des moteurs. Je pénétrai dans le luxe d’une cabine d’armateur, immense et commode. Tant pis pour l’exotisme baroudeur. J’étais la seule passagère. L’équipage – marins philippins, officiers originaires d’Allemagne de l’est, à l’exception du Second, Écossais – m’ignorait, dans le va-et-vient des manœuvres, avec un soin soupçonneux. Qui étais-je, devaient-ils se demander ? À quel désordre ou à quel espionnage allais-je m’employer ? Au nom de quel absurde romantisme d’intellectuel avais-je choisi de perdre trois semaines à rejoindre une destination à portée de dix heures d’avion ? Jean Laborde, dont je voulais percer à jour le destin, voyageant au XIXème siècle, avait lui aussi quitté sa France natale par la mer. Mais il était parti de Bordeaux, sur une goélette, pour contourner, vers l’Inde, le Cap de Bonne Espérance. Je n’étais moi-même pas dupe de ce prétexte de véracité historique. Simplement, je n’avais pu me faire à l’idée d’allier d’un bond les désertes étendues boisées du Québec et ce microcosme que j’imaginais grouillant et brûlant de Madagascar ? J’avais moi aussi besoin de remonter l’ancre, de quitter des rivages connus, d’accomplir ma mue au roulis d’océans successifs.
Assez vite, autour de mon refuge, toute animation cessa. Un silence palpable s’établit, au-delà du ronronnement monotone du système d’aération, ponctué de temps à autre d’un son étouffé de gong, ou d’un claquement d’une porte métallique. Le vent faisait moutonner les crêtes de vagues ; une tempête, disait-on, se ramassait en Méditerranée. Contre la coque, clapotait une eau verte, qui perdait de son opacité vers le large, là-bas, au-delà de la ligne fluctuante qui marquait l’extension de la zone portuaire.
« Wait, wait, and wait… Here is life on the ship: wait to come in, wait to leave the harbor, wait for the end of the run, wait to jump in the box… », me répéterait plus tard et avec insistance le Capitaine.
Mais je ne me préparais pas, moi, à faire de la mer le même usage. À peine avais-je pénétré sur le bateau que Tamatave m’était devenu un but fort aléatoire. Si le marin de la marine marchande aime la mer, n’en est-elle pas moins pour lui un espace vide qui sépare, un « rien » qui relie un port à l’autre ?
« (Le pirate) a dessein au contraire de creuser sans cesse cet espace, d’en maintenir la béance, de donner raison à l’eau contre la terre, à la géologie contre la civilisation, à l’ordre primordiale contre celui des ingénieurs. (…) Le navire pirate n’est pas lien mais solitude. Il détourne la mer de sa vocation. Même, il la restitue à sa vocation initiale, telle qu’elle était déterminée au sortir des mains de Dieu : abîme entre les terres. »
(Gilles Lapouge, Les pirates. Forbans, flibustiers, boucaniers et autres gueux de mer)
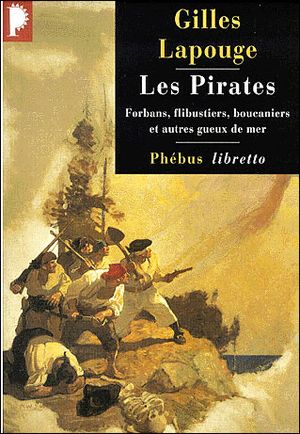
J’entrais en mer, avec l’émotion du fervent pénétrant dans le cloître d’un monastère.
La nuit envahit le port. De l’autre côté des épais hublots, le singulier ballet des dockers avait repris. Pareils à des cosmonautes, dans leur blouson et pantalon blancs gonflés par le mistral, ils guidaient avec des gestes dérisoires et des chuchotements de talkie-walkie les agissements du pont roulant, sorte de colosse imbécile. Avec une précision diabolique et un dernier ébranlement sourd, les conteneurs s’empilaient, montant devant ma fenêtre jusqu’au ciel. M’enfermant toujours davantage dans ce château de métal, cerné d’un monde minéral, écrasé par l’éclat dur des spots.
La fatigue et ce je-ne-sais-quoi d’inhumain avaient finalement eu raison de mon affût. Ce fut un lent tangage qui me tira d’un sommeil abyssal. Le bruit des machines me parvenait en une trépidation berçante. Dans cet espace parfaitement clos, tiède et plongé dans l’obscurité, il me sembla tout à coup flotter dans la quiétude même du navire, qu’une main douce roulait sur la rotondité de la terre. Je ne bougeais pas, les yeux grands ouverts vers le plafond, attentive à cette houle presque imperceptible, au couinement des portes répondant à l’oscillation, au glissement des anneaux de rideaux sur leur tringle… Une odeur de moquette, synthétique, de fer et d’huile – légère -, se laissait lentement envahir par un parfum de sel, d’humidité.
Nous avions quitté le port, le Catherine Delmas était rendu à la mer…
Cette certitude m’emplit brusquement d’une jubilation qui me laissa interdite, le corps pénétré d’une mollesse bienheureuse.
Plusieurs fois dans la nuit, je m’éveillai ainsi, attentive, goûtant le balancement et la rondeur, me disant, avec un émerveillement naïf : « me voilà partie ».
